Moderne barbarie
Aujourd'hui no 51 (29 octobre 1999)
Aujourd'hui, pour gagner sa vie en travaillant, il ne suffit plus d'exécuter la tâche pour laquelle on est payé. Il faut y mettre le meilleur de soi-même, adhérer à son entreprise. L'employé qui conservera &endash; peut-être &endash; son boulot sera celui qui ne compte pas ses heures, qui ne rechigne pas à déplacer ses vacances, qui emmène du travail le soir à la maison. Le mérite premier du livre de Le Goff est de démontrer que ce comportement, qui s'impose comme la norme n'est, justement, en rien "normal". Il est le résultat de la "modernisation", depuis une vingtaine d'années, de l'organisation du travail, selon les discours et les méthodes des professionnels du management et de la formation.
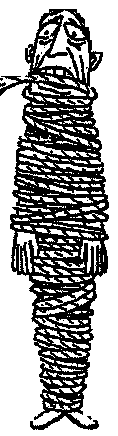
La Barbarie douce : la modernisation aveugle des entreprises et de l'école, Jean-Pierre Le Goff, La Découverte, 1999, 125 p., (Sur le vif).
Si l'auteur donne à ce phénomène le nom de "barbarie douce", c'est que les spécialistes prétendent mener ces changements au nom du bien-être des travailleurs censés devenir plus "autonomes", plus "libres". Cette modernisation est opposée à l'ancien modèle d'organisation du travail "archaïque" et autoritaire du XIXe siècle : il n'est plus question d'imposer brutalement les changements à l'employé. Celui-ci devient un partenaire actif, qui "s'implique". Toute une batterie d'outils est déployée par les professionnels de la gestion des ressources humaines pour prendre l'avis des travailleurs, les aider à manifester leurs attentes, etc.
En fait, on demande toujours plus aux employés. Ils doivent, non seulement, être mobilisés en permanence (heures supplémentaires, flexibilité, etc.) mais, de plus en plus, ils doivent engager toute leur personnalité : cela implique « des comportements qui relevaient antérieurement de la sphère privée et de la liberté personnelle ». C'est ainsi qu'est apparu le "savoir-être" qui vient se rajouter à l'ancien "savoir-faire".
Le comportement de chaque travailleur va être analysé et comparé à un comportement type défini par les études des professionnels de la ressource humaine. Le Goff cite l'exemple de deux logiciels "d'auto-évaluation", mis au point par Électricité de France (EDF), censés permettre à « l'agent de bien se connaître et construire son propre projet professionnel ». En fait, il s'agit de déterminer « le profil comportemental d'individu », c'est-à-dire de « repérer ce qui peut motiver une personne, éviter une grande démotivation […], une faible productivité, [etc.] ». On mesure si l'agent correspond aux attentes de l'employeur, et "l'auto-évaluation" consiste à savoir ce qu'il doit modifier dans son comportement pour y répondre.
La volonté de manipulation des individus qui commandent à ces techniques apparaît clairement dans la littérature managériale qui préconise d'établir une « relation de confiance réciproque » qui « provient davantage d'un lien émotionnel fort que d'un raisonnement intellectuel et d'une adhésion rationnelle ». Tout ceci, bien entendu, serait bon pour les employés et les gestionnaires affirment que le « sentiment d'émotion et de satisfaction qui les lie à l'entreprise [est] une relation nettement plus saine et sincère que la dépendance dans laquelle les plonge la sécurité de l'emploi ». Ces propos sont légitimés et objectivés par l'apparence scientifique qu'ils se donnent, notamment avec l'utilisation d'un « discours pseudo-savant » : on parle d'employé « réactif » et « participatif » qui utilise, entre autres son « savoir mobiliser », son « savoir combiner », son « savoir transférer » sans oublier « l'image opérative commune » de la compétence collective. Des semblants de théories permettent à ces spécialistes du comportement d'aboutir à de véritables lois en la matière qui, comme par hasard, coïncident avec les besoins de l'entreprise moderne. Citons : « l'autodiscipline est une norme de performance qui émane de chaque individu ».
Ce phénomène ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise, il pollue l'ensemble de la société. Le Goff s'intéresse à son adaptation et à ses effets dans l'enseignement. Par exemple, dès l'école maternelle, « un livret d'évaluation [qui] permet le "suivi" de l'acquisition des compétences » ne comporte pas moins que « quatre-vingt-neuf compétences » divisées en d'innombrables catégories et sous-catégories parmi lesquelles, on trouve « manifester l'envie d'apprendre », « contrôler ses réponses par rapport à une consigne », « mener un travail à son terme », etc. Ici, comme dans l'entreprise, "l'autonomie" et la "participation" sont des obsessions : l'enfant doit « affirmer son autonomie dans l'espace, par rapport aux objets et aux personnes » et se prononcer sur les activités qui lui sont proposées ; « des enfants de quatre à cinq ans […] sont quasiment sommés […] de s'exprimer sur leur séjour et on laisse entendre que ce faisant, ils prendront part aux décisions ». Cela conduit à une école dans laquelle « le thème de la réussite revient comme un leitmotiv » : la maternelle devient un « tremplin vers la réussite », premier échelon « d'une société qui érige la responsabilité de tous, concept novateur, volontariste, en un principe intangible ».
Comme nous venons de le voir, ces nouvelles techniques servent à merveille le libéralisme économique. Mais selon Le Goff « l'autonomie et la transparence dont se réclament ces outils ne trouvent pas leur fondement dans la sphère économique ». La barbarie douce est « symptomatique de la décomposition des repères qui structuraient antérieurement le vivre ensemble et l'action collective », et trouve sa source dans, ce qu'il appelle, « l'héritage impossible de 1968 ». Son idée est que les remises en question fondamentales qui ont été faites à cette époque, mais qui n'ont pas pu se concrétiser, ont conduit à une situation d'affaiblissement des institutions existantes, sans que rien ne les remplace. Ainsi des thèmes comme l'autonomie ont été instrumentalisés, « mis au service de la gestion économique » notamment, par une gauche moderniste, pour assurer son virage gestionnaire. Il s'agissait, pour cette dernière, de brandir des thèmes "éthiques" pour masquer sa conversion à l'économie de marché.
En dépassant l'exemple français, on peut légitimement penser que les idées qui ont secoué l'« ancien monde » ont été d'autant mieux digérées puis utilisées pour le refonder, que ceux qui dirigent aujourd'hui sont ceux-là même qui les portaient hier. Cependant, Le Goff parle au nom d'une certaine nostalgie &endash; même s'il s'en défend &endash; que trahit son jugement sur « les élites de la modernisation d'après guerre [qui] disposaient d'une culture humaniste et d'une expérience humaine, acquises à travers l'enseignement et les épreuves de la guerre ». Rien d'étonnant alors qu'il préconise la refonte d'institutions comparables à celle du passé et capables de favoriser « un lien entre dirigeants et dirigés qui ne débouche pas sur l'ignorance et le mépris, tout en reconnaissant comme légitimes les différences et les conflits ». Certes, le fait de rendre à nouveau lisible les antagonismes entre salariés et patrons est un enjeu fondamental, mais il faudrait que ce travail s'accomplisse dans le sens d'une libération réelle des travailleurs, et non pas dans celui du rétablissement d'anciens rapports que Le Goff tend à embellir. Lorsqu'il invite à « revivifier une culture politique démocratique et républicaine, qui est le meilleur de notre tradition », il oublie que cette tradition était l'alliée de l'exploitation économique d'alors, comme la "culture managériale" l'est de celle d'aujourd'hui. Le Goff ne remet pas en question cette exploitation, il la souhaite contenue par la politique et la culture.
Sur ce terrain-là, nous ne le suivrons absolument pas. Que les nouvelles méthodes de gestion s'intègrent au capitalisme, mais n'en soient pas le fruit direct, ne change rien au fait qu'elles le servent. Si ces manipulations sont possibles, c'est aussi à cause de la nouvelle donne économique. Sans le chantage à l'emploi permanent, il serait plus facile pour les travailleurs de refuser de jouer le jeu.
G. Amista